L'île aux Morts et l'île Trébéron

Ile des/aux Morts.







Mur de quarantaine.

Vestiges actuels de la poudrière de 1000m² pour un stockage de 250 tonnes. Chaque bâtiment de l'île aux Morts fait 45 m de long et 22 m de large.

Ile Trébéron (Est).





Les latrines sous le lierre, une façon de limiter les contagions par les excréments. La cale au niveau de l'eau recevait les militaires en quarantaine que l'on faisait se déshabiller immédiatement avant qu'ils ne se brossent mutuellement à la paille, puis rincer à l'eau de mer. La maison en premier plan est l'étuve dans laquelle on faisait bouillir les vêtements que les soldats nus attendaient avec impatience sur la cale. Le seconde petite maison était un poste sanitaire occupé par les médecins à qui revenait la tâche de diagnostiquer une fièvre. Derrière, les vestiges du mur séparatif qui délimitait les zones de quarantaine. L'étuve deviendra la maison du gardien quand le site sera désaffecté et ceci jusqu'en 1960. Ensuite c'est l'abandon définitif.



Vestiges actuels du lazaret de l'île Trébéron.

Latrines Est.

La cale du lazaret de Trébéron. Au centre gauche, les latrines. Au centre droit le mur de séparation entre les malades et les valides. La cale par laquelle arrivait les marins en quarantaine et par laquelle les cadavres étaient transférés vers l'île des Morts (ancienne Petite île de Trébéron).

Les deux îles Trébéron à droite et celle des Morts à gauche, aujourd'hui.

Les îles rattachées à Rostellec (Callac / Halleg : les
saules) étaient à l'origine des biens privés de la famille Provost (Seigneur
de Trébéron) ayant résidé au manoir de Gouerest, puis à celui de Quélern
tout en étant propriétaire de celui de Trébéron.
Les équipages ayant participé à la bataille navale du cap Bévéziers le
10 juillet 1690, en Manche, contre la marine anglo-hollandaise sont hautement
contagieux et séjournent en quarantaine sur l'île de Trébéron par volonté
royale. Ils vivent sous des toiles de voile à même le sol. L'eau et la
nourriture viennent par chaloupes ou gabares de Roscanvel. Il est préférable
d'exposer la population de Roscanvel plutôt que celle de Brest qui compte
une amirauté. Le médecin est le docteur Olivier qui ne parle pas de lazaret
mais d'ambulance provisoire.
Le 24 juin 1697, un navire corsaire malouin entre en rade et se met aux
abords de l'île de Trébéron pour accueillir des marins, des prisonniers
et des biens provenant de la Barbade et de Virginie. Cette fois, des baraques
sont construites avec des bois provenant du démantèlement du navire Saint-Martin
et ceux d'une galère.
Le lazaret reçoit dès août l'équipage et les prisonniers de Mr de Pointis
provenant du détroit de Baham.
A cette époque, l'absence d'eau douce à disposition sur l'île fait penser
qu'une installation sur l'Île Longue serait préférable. L'île Trébéron
est abandonnée pour manque de praticité et difficulté de surveillance
des prisonniers. Cet abandon est remis en cause en mars 1705 quand des
logements sont reconstruits et améliorés. Deux gardiens sont nommés pour
surveiller du mobilier d'hôpital mis à disposition. Le premier équipage
en quarantaine dans cette nouvelle disposition est celle de la Bellone.
D'autres navires viendront ensuite.
En 1721, une recherche de source d'eau potable est menée partout sur l'île.
In-extremis, un puits est en chantier. Plusieurs ports français connaissent
la peste, elle ne devrait pas tarder à Brest.
Il se dessine des travaux sans fonds réels... Une enveloppe de 3000frs
est le seul financement connu. Dérisoire. Les navires Mercure et Prothée
venant de Sude en Candie, arrivent en rade en avril 1722. Les travaux
sont peu avancés, les 3000 frs escomptés ne sont pas versés. Il y a un
effort de fait côté matériel de chirurgie mais aucun bâtiment sain n'est
élevé. On parfume pour désinffecter les hommes et les vêtements...
Les marins en quarantaine arrivent par centaines désormais. Escadre du
marquis d'Antin en 1741. Escadre du comte de Roquefeuil en 1746. Des centaines
de marins contaminés. Les installations ressemblent davantage à des infirmeries
de champ de bataille.
En 1756 (1757 selon certaines sources), Emmanuel-Auguste Cahideuc Dubois
de la Motte, officier de Marine réputé (lieutenant-général), revient avec
sa flotte de L'île Royale de toute urgence. Tous ses hommes ont le typhus.
Ils rentrent de la guerre contre les Anglais pour conserver le contrôle
de Louisbourg, une forteresse de Nouvelle-Ecosse (Canada). Ceux-ci sont
répartis sur l'île de Trébéron qui n'a toujours pas de réels aménagements.
La grande île de Trébéron et la petite île de Trébéron sont propriétés
de son épouse. Les équipages du Célèbre et du Bizarre amènent leurs premiers
mourants le 4 novembre. D'autres navires se regroupent. Sur l'île, on
y campe sommairement dans des conditions épouvantables. Le typhus se répand
sur la Presqu'île de Crozon et à Brest. On parle de 4000 matelots atteints
agglutinés sur le rocher de Trébéron. Intenable : des évacuations de matelots
sont opérées vers les hôpitaux des casernes brestoises de Recouvrance,
dans les églises alentours, dans les couvents des Carmes et des Capucins,
dans le séminaire des Jésuites et enfin dans l'hôtel des gardes de la
Marine. Le personnel hospitalier est infecté, on propose à des bagnards,
contre remise de peine, de se charger des malades.
1758, le 11 janvier, l'escadre de Mr de Kersaint ramène des scorbutiques
que l'on laisse à bord au mouillage à proximité de l'île de Trébéron.
Seulement 154 lits installés sur cette dernière. Une écatombe selon les
écrits anciens qui évoquent 10000 morts.
Au vu de la fréquentation incessante des marins atteints ayant séjourné
sous les tropiques, il est enfin décidé de monter un bâtiment adéquat.
750 bagnards arrivent à Brest en 1768, le maire s'oppose à leur entrée
en ville. À cette époque, il n'y avait personne sur Trébéron, ils y furent
conduits. Une centaine va y mourir. Ils seront enterrés sur l'île aux
Morts (ex grande Trébéron). Le lazaret (construit en 1772 par les bagnards
pour l'essentiel et dont le nom est une déformation du mot Nazareth) est
un hôpital dispensaire qui accueille les marins en quarantaine. 40 jours
d'isolement (en réalité 21 jours) pour être sûr qu'aucune fièvre contagieuse
ne se diffusera insidieusement dans le port de Brest. Les rotations des
marins sont calculées selon le nombre de personnels embarqués qui peut
aller jusqu'à mille hommes par navire. L'hôpital dispose de 200 places,
d'une chapelle et d'une chambre de dissection en vue d'autopsies conduites
par des équipes médicales.
1779, le 13 septembre, deux escadres arrivent, celle du comte d'Orvilliers
et une autre espagnole. 7000 marins malades à soigner...
Les marins malades mouraient et étaient enterrés sur l'île aux Morts toute
proche. Choléra, fièvre jaune et bien d'autres maladies étaient à craindre
jusqu'à ce que la navigation coloniale décline.
Ce seront les Soeurs de la Sagesse, des religieuses, qui feront office
de personnel soignant bien souvent et ceci depuis le règne de Louis XIV
durant lequel, elles se sont portées volontaires pour être exposées aux
pires épidémies. A Trébéron, il est dit qu'aucune sœur ne fut malade
alors que certaines y passèrent de nombreuses années, voire "toute
une vie".
Dès 1808, l'aspect militaire entre en jeu, l'île aux Morts est devenue
stratégique. La poudrière de Recouvrance à Brest côtoie des maisons d'habitation.
Un tir d'artillerie ennemi et c'est tout un quartier qui disparaît. L'inquiétude
est grande parce qu'une frégate anglaise, et ceci malgré le dispositif
de défense du goulet, est venue narguer le port de Brest en tirant deux
salves.
Une poudrière est élevée sur l'île afin de fournir le port militaire de
Brest. L'occupation des sols de l'île aux Morts est telle, que dorénavant
l'île de Trébéron fera office de lieu de soin et de cimetière (au Nord
de l'île). Les bâtiments des magasins de poudre sont construits par des
bagnards de Brest qui espèrent s'évader. Les travaux sont conduits par
Nicolas Trouille (1752-1825) qui n'est autre que l'ingénieur et directeur
des travaux maritimes de la place de Brest en ce qui concerne les constructions
non défensives. Les travaux durent de 1808 à 1814. Il s'agit de son dernier
chantier d'importance.
1809, le lazaret accueille 964 galeux.
1813-1818, travaux d'extension.
1825, l'escadre de Pierre Roch Jurien de la Gravière, revenant des Antilles
ramène des équipages malades, trop nombreux pour être soignés en un seul
service de soins.
1826-1832, nouveaux travaux mais cette fois, il s'agit de rénovations
urgentes à peine financées.
En 1828, l'île est séparée en deux par un mur pour que les malades contagieux
n'aient plus de contact avec les biens portants. Une épidémie de dysenterie
sévit alors. Versant Nord les biens portants. Versant Sud les malades.
Il est un temps où le décor sinistre de l'île fait envisager d'installer
le lazaret sur l'île Longue à nouveau. On y parle ainsi d'aide à la guérison
de l'âme (1835)...
1856-1858. Cette fois les réfections sont complètes et d'ampleur, on pense
même à semer des pins et à paysager l'endroit pour un semblant d'humanité.
1887, 4 août. Réception de travaux au lazaret par le sous-préfet de Brest
en présence d'une commission composée du directeur du service de santé
le docteur Anner, de l'ingénieur des ponts et chaussées Willotte, du mécanicien
principal de la marine Campi.
1892, fin avril début mai. Exercices pratiques de torpilles organisés
pour instruire les élèves de la première division de l'école navale à
bord du Borda. Un torpilleur exécute des tirs de destruction. Les élèves
sont sur l'île de Trébéron pour apprécier les explosions.
1892, novembre décembre. Présence de 292 marins en observation pour six
jours. Leurs objets personnels sont passés à l'étuve sur Trébéron. Ils
seront reconduits au 2ème dépot de Brest mais aussi pour certains détachements,
vers Cherbourg et Toulon. 266 marins aprentis fusiliers de Lorient arrivent
le 19 décembre.
1893, avril. 8 jours d'observation pour des soldats Lorientais ayant eu
contact avec des cholériques. Des artilleurs viendront ensuite. En octobre
le lazaret est fermé. Conseil de guerre pour un matelot qui n'a pas suivi
les consigne de quarantaine en quittant l'île de Trébéron par peur d'être
contaminé. L'île est commandé par un conducteur de détachement (enseigne),
cette année là, il se nommait Hivin.
1896,12 janvier. La torpille n°14 égarée lors d'un exercice par la première
division de l'escadre du Nord de l'amiral Barrera, en rade, est retrouvée
par le gardien du lazaret sur la grève. Une canonnière la récupère et
la remet au Suffren.
1897, 20 juillet. Comme deux fois par an, une canonnière ainsi qu'un ponton
ont apporté sur l'île, l'ensemble du change : draps, couvertures, traversins,
oreillers, pansements...
1899, 18 mars. Mouillage de torpilles par le Surcouf à l'île de Trébéron.
1900, l'étuve de Trébéron est la seule de la région militaire de Brest.
Elle est implantée par le ministère de l'Intérieur et au service du docteur
Anner, directeur de la santé.
1901, 4 mai. Mise en quarantaine de la Canonnière Capricorne. Deux cas
de fièvre jaune. Tout le contenu de la canonnière est passé à l'étuve
et la garde du navire est mise en quarantaine. L'équipage quant à lui
est à Brest sans contrainte.
1906, février. La pharmacie générale et le lazaret lui-même seront désormais
surveillés par des gardes-consignes auxiliaires ou des gendarmes à la
retraite pour remplacer les gardes-consignes (0.75fr par jour) de 1ère
et 2ème classe.
1906, 22 mars. Le Forbin et deux contre-torpilleurs font des exercices
de torpillage de rails et de poteaux télégraphiques. Ces exercices sont
trimestriels.
1908, 3 mai. Désinfection, sous les ordres du 1er maître Cadeville, de
l'aviso Chamois à Trébéron après un cas de méningite cérébro-spinale.
Les dernières craintes épidémiques auront été celles des oreillons en
1908 à Brest. Le transfert au lazaret a été envisagé un temps avant que
la maladie ne s'estompe d'elle-même. En 1909, le cuirassé Dévastation
resense des cas de méningite, ce sera la dernière mission sanitaire.
Le lazaret est devenu un sanatorium d'été (création amiral Boué de Laperrère)
pour les marins malades du tabac et de l'alcool ainsi que les tuberculeux.
Eté 1909, 1910, 1911 jusqu'au 10 novembre. A cette dernière échéance,
il y a 30 malades. Autorisation du ministre des Colonies que loge le médecin
et sa famille sur place sans défraiement. Le sanatorium doit être autonome
en alimentation. Activité interrompue à deux reprises faute de moyens
malgré les encouragements du docteur Cazamian persuadé du bien fondé de
ses soins sur place. Le médecin général de Brest Hyades partage cette
opinion. Le ministre Théophile Delcassé ne veut pas entendre parler du
moindre coût supplémentaire évalué annuellement à 310000frs et que les
médecins Brestois espéraient voir passer à 320000frs. Le ministre ordonne
que les bâtiments soient désinfectés et mis en sommeil avec l'accord du
ministre de l'Intérieur pour un classement en hôpital d'isolement... non
entretenu.
En 1911, le fils aîné (Aimé - apprenti gabier) du gardien de phare Désiré
Matelot est en soin. Son père décédé en service au phare de Kerdonis avait
fait la une de la presse Nationale. L'épouse du défunt avec deux de ses
enfants avaient fait tourner la lanterne à la place de son mari mort soudainement
pour éviter les accidents maritimes. Le geste à des moments difficiles,
avait été célébré partout en France. Une souscription permit de réunir
15000frs pour subvenir aux besoins de la famille en difficulté. C'est
le poète Saint Pol Roux qui signale le fait...
La vocation sanitaire ne fut pas la seule, il y eut la période des prisons
avec des forçats dès la fin du 18ème siècle, des déportés arabes, des
communards (1871). Ces derniers étaient entassés sur des pontons et des
bateaux dans les environs, ce qui déclencha des drames sanitaires. Sur
l'île de Trébéron un bataillon de marche du 19ème RI monte la garde.
Durant la première guerre mondiale des soldats blessés passeront leurs
convalescences sur l’île de Trébéron. Ils y côtoieront un millier de prisonniers
Allemands et Autrichiens jusqu'en 1919. En janvier 1919, le vapeur allemand
Sierra Ventana débarque 1400 prisonniers immédiatement pris en charge
les équipes du médecin principal Denis, pour soins, vaccinations et habillements
avant de les renvoyer vers Brest pour repartir dans leurs foyers.
1925, 1 mai. L'île de Trébéron est gardée par un unique gardien civil.
Décision du ministre de la Marine.
L’hôpital sera à nouveau opérationnel pendant la seconde guerre mondiale
pour soigner des soldats alliés ou adversaires sans distinction.
Les trois poudrières de l’île aux Morts sont construites sans aucun métaux
pour éviter les réactions chimiques explosives. Ce sont aussi des bagnards
qui contribuèrent aux chantiers entre 1808 et 1814.
Dès 1868, ces poudrières ne sont plus d'actualité pour l'armée. Elles
sont transférées à St Nicolas en Guipavas bénéficiant ainsi des voies
ferrées. La puissance des canons a évolué tellement que la poudrière peut
subir un tir provenant de l'anse de Camaret et exploser en privant ainsi
l'escadre de Brest de ses poudres.
L'armée allemande stockera des munitions sur l'île aux Morts au cours
de le Seconde Guerre Mondiale et s'en servira aussi comme prison pour
des civils. Certains parlent de torpilles en particulier ceci d'autant
que la base sous-marine de Brest en réclamait un grand nombre.
Le Manoir de Trébéron de la famille Provost pourrait être à l'origine des noms des îles Trébéron. Dernier détail, ces îles ont été aussi des carrières de microgranite pour la production de pavés employés sur des chaussées militaires.

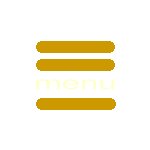


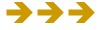 La
bouteille de
La
bouteille de 

