Batteries hautes et basses de Fort Robert
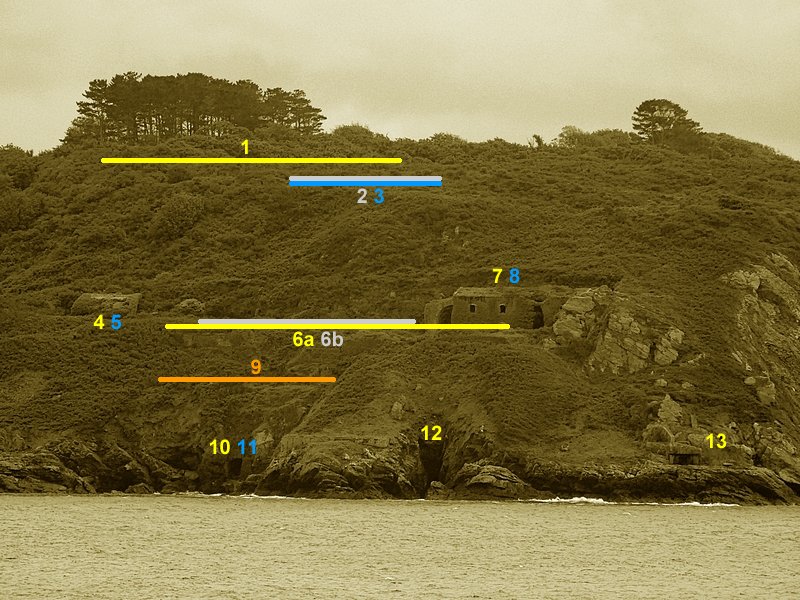
1 Batterie
haute française de bombardement de 4 canons de 32cm construite en 1888
démantelée vers 1915.
2 Batterie française
de 4 canons de 75mm de 1926.
3 Batterie allemande
provisoire récupérant les 4 canons de 75mm de 1926.
4 Usine électrique française.
5 L'usine est réemployée par l'armée
allemande tant que la batterie de 75mm est en service.
6a Batterie basse française
de 1862.
6b Batterie française de
4 canons de 47mm de 1894.
7 Caserne défensive
française de 1857.
8 La caserne est réemployée
par les artilleurs Allemands au service des canons de 75mm et du projecteur
de 150cm.
9 Batterie de Vauban
- 1ère position française d'origine - 18ème siècle.
10 et 12 Batterie
française de rupture pour 2 canons de 32cm démantelée en 1915.
11 L'armée allemande réutilise
la galerie pour installer un projecteur Siemens de 150cm.
13 Postes français de projecteurs
de recherche de 1890.
Magasin de poudres sous roc de la batterie haute de Fort Robert

Salle principale avec son rail de plafond, ses rigoles à la périphérie du sol. Au delà du couloir, la pièce du monte-charge. A l'origine étaient accrochées des tôles ondulées qui faisaient parapluie et déviaient l'eau de la roche qui s'était infiltrée aussi dans la coque en maçonnerie du plafond. L'eau de ruissellement gouttait et tombait dans les rigoles pour être évacuée par l'égoût au fond à gauche.

La pièce du puits de lumière / monte-charge, un petit couloir éclairé d'un créneau de lampe au dessus de la voûte, enfin, un dernier petit local technique qui servait au chargement et à l'amorçage des projectiles.

Le créneau de lampe éclaire la colonne du monte charge et le local d'amorçage en arrière.

Le créneau de lampe côté local d'amorçage.

La colonne des charges.

L'égoût dont l'entrée côté magasin était obturée en dehors d'une petite grille d'évacuation.

L'escalier d'accès.
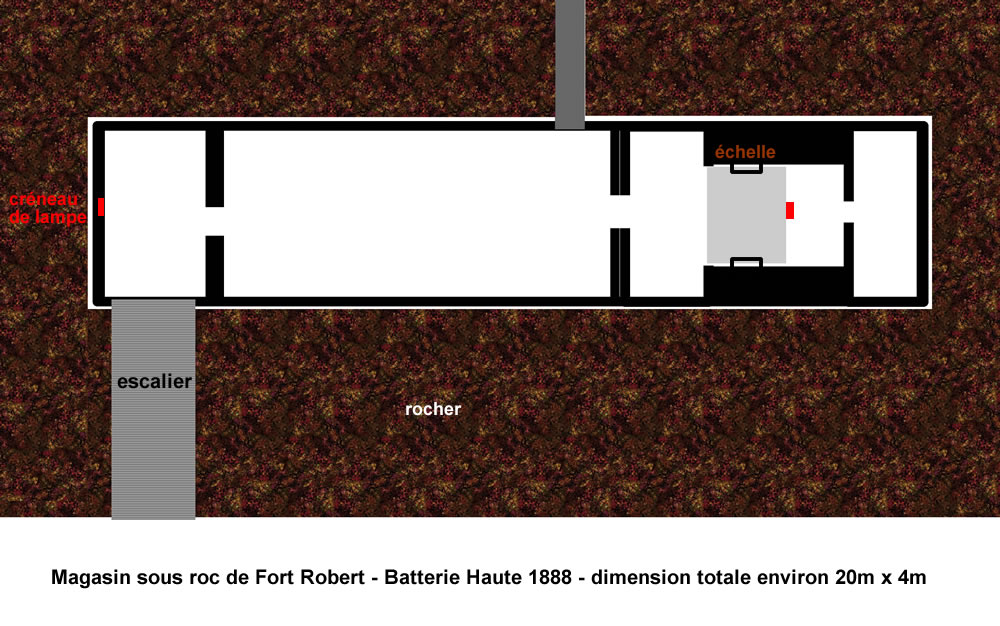
Le magasin de poudres sous roc de la batterie haute
de Fort Robert obéit aux normes militaires de construction en vigueur
à la fin du 19ème siècle. A environ 9 m de profondeur dans la roche de
la falaise, une galerie de 20 mètres de long et 4 de large approximativement
dont chaque pièce est voûtée sur sa longueur fut creusée vers 1888.
L'éclairage se fait par créneaux de lampe.
Une colonne verticale fait office de puits de lumière mais aussi d'issue
de secours au vu des échelles, et surtout de monte charge pour que les
munitions chargées arrivent sur la plate-forme extérieure de la batterie
de 4 canons de 32cm modèle 1870-81 sur affût 1888 PC.
Les poudres et les hommes arrivent par un grand escalier descendant. Les
poudres sont suspendues au rail du plafond et sont livrées avec un moindre
effort dans la grande salle où elles y sont entreposées.
Les obus de 32 cm faisaient de 338 kg à 392 kg pièce selon la quantité
de charge, ils étaient donc intransportables sans assistance de levage.
Soutes de surface de la batterie haute


Chaque soute était numérotée, un grand 1 rouge au plus haut pour celle-ci.

Chaque canon était sur une plate-forme à parapet en hauteur. Par contre au niveau du sol de circulation de la batterie, chaque canon avait une petite soute en forme de demi-igloo en béton et moellons. Une porte d'accès à deux vanteaux fermait l'abri.
Abri de traverse de logement batterie haute



Abri de traverse pour la troupe. Appelé aussi abri logement. Se diférencie des abris à munitions par l'adjonction des fenêtres. Un plan modèle type est daté 1886. La voûte est recouverte d'une épaisse couche de terre pour absorber l'explosion des obus.
Poste d'observation de commandement et de télémétrie haut de Fort Robert







Poste de commandement, d'observation et de télémétrie (Nord) de la batterie d'origine soit celle de 4 canons de bombardement de 32cm. 2 fois deux pièces séparées par un couloir menant au poste circulaire. Sur les murs des plots d'attache des volets métalliques blindés.
48° 20' 15.3" N
4° 33' 9.8" O
Poste d'observation haut de Fort Robert




Ce poste d'observation commande la batterie de 4 canons de 75 mm installée en 1926.
48° 20' 14.3" N
4° 33' 13.9" O
Casernement de la batterie basse




Créneaux de tir pour protéger l'entrée.

Caserne à un étage aux plafonds voûtés anti-bombardement.



Le casernement de la batterie basse avec ses arcs-boutants est une caserne défensive datant de 1857 qui sert une batterie déjà en usage à partir du 17ème siècle équipée de 6 canons de 30 livres de balle et 6 obusiers de 22 cm en fer, équipement de base placé bas qui perdurera avec peu d'évolution jusqu'en 1862. A cette période la batterie est redessinée. Lors de sa construction, ce bâtiment dispose de normes élevées de solidité qui fait de lui un patrimoine militaire unique.
48° 20' 16.9" N
4° 33' 16.2" O
Usine électrique de la batterie basse


Surélévation du matériel pour éviter le contact de l'eau.


Abri sous roc de l'usine.
L'usine électrique produit et fournit l'électricité de la batterie basse et tout particulièrement l'énergie nécessaire aux projecteurs bas.
48° 20' 17.5" N
4° 33' 12.1" O
Postes de projecteurs batterie basse


2 postes de projecteurs sous casemates construits en 1889/1890. Le projecteur de 60 cm de type FT trace perpendiculairement au Goulet de Brest au ras des flots. Le projecteur de 90 cm de type FT trace vers l'entrée du Goulet de Brest.




Chaque poste de projecteur est à deux niveaux : niche voûtée haute reliée à la salle de feu par un puits à échelons.



Salle du feu de 60cm avec une platine tournante pour sortir le projecteur à l'extérieur ou le rentrer dans son abri dans un déplacement en angle si nécessaire.


Plate-forme de sortie du projecteur de 60 cm sur rail.





Salle du projecteur avec son échelle de pallier.

Embrasure du projecteur de 90cm et un volet blindé.
48° 20' 17.4" N
4° 33' 18.6" O
Batterie de canons de 47mm à tir rapide.

Embase d'un canon de 47mm TR de 1894.

Parapet construit pour la batterie de 4 canons de 47mm.
La Pointe de Fort Robert est occupée par la défense littorale
militaire française depuis plusieurs siècles. Il est avéré qu'en 1697,
il existe une batterie côtière sur site composée de 7 canons de 36 livres
juste au dessus du niveau de la mer sur une plate-forme en terre avec
un parapet rudimentaire. Le déroctage et le terrassement furent nécessaires.
Un casernement existe aussi pour 24 artilleurs sur une plate-forme artificielle
un peu plus élevée probablement celle qui a servi au casernement du 19ème
siècle. La batterie est ensuite remplacée et diversifiée grâce à 6 nouveaux
canons de 30 livres de balle et 6 obusiers de 22cm en fer.
En 1784, la batterie est inventoriée : "batterie Robert".
Les tensions géopolitiques avec l'Angleterre se répétant à chaque siècle,
la circulaire ministérielle du 31 juillet 1846 du ministre de la guerre
émanant de travaux d'une commission mixte des fortifications de la côte
impose une remise en chantier de la batterie considérée alors en 1ère
catégorie opérationnelle. L'appréciation des travaux à envisager est publiée
en commission le 7 novembre 1844. Et si la circulaire de 1846 donne l'ordre
d'exécution des travaux, ce n'est que de 1857 à 1859 qu'une caserne défensive
à arcs-boutants est élevée alors que les projets initiaux avaient prévu
un corps de garde modèle N°1 type 1846. Cette caserne défensive bien qu'elle
obéisse à des normes de construction anti-bombe de l'époque, elle est
une interprétation locale d'un plan normé ce qui donne à cette caserne
toute sa valeur patrimoniale historique. Son toit à deux pans à faibles
pentes couvre des voûtes capables de supporter les explosions de projectiles
du 19ème siècle. Cependant afin que les murs verticaux ne s'écartent pas
sous le choc, les arcs-boutants absorbent les vibrations ainsi que les
poussées destructrices et réduisent considérablement les risques d'effondrement
de la structure à deux niveaux - niveau supérieur chambrée pour 48 hommes.
Le toit récupère les eaux de pluie pour les envoyer dans un citerneau
filtrant puis dans une réserve à eau en sous-sol. Des créneaux de fusillade
percés dans les murs permettent de soutenir un siège d'infanterie.
En 1862, ce sont des parapets de soutènement des terrasses qui sont renforcés
ou élevés pour plus d'espace afin que les 60 artilleurs (environ) puissent
servir les pièces d'artillerie dont les modèles semblent inchangés bien
que plusieurs recommandations de différentes commissions aient réclamé
un renforcement des calibres dès 1870 par des canons rayés de 27 cm et
30 cm sans que cela ne soit suivi des faits.
En 1888, la préférence est donnée à une batterie de rupture sous roc,
ainsi bien mieux protégée des obus ennemis. Les galeries creusées dans
la falaise accueillent deux canons de 32cm modèle 1870-1884 sur affût
de casemate de 1888 pour des tirs directs. Ces canons géants seront reversés
sur le front de l'Est en 1915 et réemployés sur des rails de chemin de
fer contre l'Allemagne.
Durant la même année 1888, la batterie haute est mise en chantier en arc
de cercle pour 4 canons de 32cm modèle 1870-1884 sur affût 1888 Pivot
Central. Cette batterie au sommet de la falaise bombarde l'ennemi intrusif.
Un poste d'observation est ajouté en hauteur. Un magasin sous roc est
creusé.
Le 20 février 1889, la batterie casematée basse est maintenue en activité
à la Chambre par le projet de loi portant classement et déclassement des
ouvrages de défense en France et en Algérie, sur avis du comité de défense
et du conseil supérieur de la guerre.
En 1889, il est proposé de disposer de 4 canons à tirs rapides de 47mm
modèle 1885 affûts M modèle 1885 crinoline sur l'ancienne batterie de
Vauban. Puis après considération de la trop grande proximité des canons
avec la mer lors des grandes marées, ces canons sont placés en 1894 sur
une plate-forme un peu plus élevée épaulée par des murs de soutènement.
La caserne défensive sert de magasin.
A cette même période, sont construits deux locaux bétonnés pour projecteurs
60cm Mangin feu de tir et 90cm Mangin feu de reconnaissance. Le projecteur
de 60 cm de diamètre a la possibilité d'être sorti de sa casemate par
déplacement sur rail et se retrouver ainsi en premier abord de la mer
pour suivre les navires ennemis s'aventurant la nuit dans le goulet. Le
modèle de 90 cm est positionné dans sa casemate et a pour orientation
principale L'Ouest soit la direction de l'arrivée probable de l'ennemi
et ceci à titre de reconnaissance. En retrait une usine électrique fournit
l'énergie. Les casemates des projecteurs sont fermées par des volets blindés.
En prenant l'exemple du projecteur Mangin (du nom du colonel du Génie
qui a conçu la lentille principale convexe-concave) de 60 cm, l'appareil
fait 580 kg et est une variante de l'appareil de 40 cm pour l'armée de
terre. Portée maximale 6 kilomètres dans de bonnes conditions atmosphériques.
1600 becs. En général une machine de Gramme et le moteur Brotherhood lui
sont associés pour un poids de 1200 kg. Ce modèle de 60 cm est aussi un
modèle embarqué de référence dans la Marine Française et présent dans
la Navy (marine américaine). La présence de ces projecteurs est avérée
en 1913. Un poste de commande de projecteurs se situe un plus haut en
falaise.
Après la première guerre mondiale, la batterie basse de Fort Robert est
déclassée dans l'ordre d'importance, elle devient secondaire.
En 1922, un projet d'armement par 4 canons de 75 mm modèle 1908 Schneider
Marine sur affût crinoline 1908 est envisagé et devient effectif en 1926.
C'est donc la version du canon de 75 mm de marine modifié pour la défense
de côte. Ces quatre canons fixés au sol par une platine métallique sont
à l'air libre et n'offre aucune protection pour les artilleurs. Il fut
donc nécessaire d'élaborer un blindage mince type masque - enveloppement
du canon hors tube en avant et hors culasse en arrière - construit sur
mesure à l'arsenal de Brest. Ces pièces d'artillerie de 75mm
1908 Marine, avant modifications, provenaient de cuirassés de la classe
Danton.
En 1940, l'unité d'artillerie de marine allemande 6./M.A.A.262 récupère
la position des canons de 75 mm et installe un projecteur de 150 cm Siemens
dans une alvéole rénovée d'un canon de rupture au niveau de la mer. L'ancienne
caserne défensive sert de casernement aux soldats germaniques.
Vers 1941, une batterie anti-aérienne allemande de trois canons de 40mm
est installée au sommet de la falaise, celle-ci est codée Cr 334.
En 1943, la batterie de 75mm est entièrement démantelée pour être versée
sur l'autre rive du Goulet - Toulbroc'h.
Construction d'une torpedosperrbatterie
fin 1943, début 1944 un peu plus à l'Ouest de la Pointe Robert par l'armée
d'occupation qui rejoint l'esprit des batteries de rupture française par
un lancé de torpilles au ras des flots.
En 2007, destruction d'un important stock de munitions allemandes de 40mm.
Dès lors Fort Robert est à l'abandon bien que terrain militaire jusqu'en
2009.
• Le quartier maître Léon de la défense
fixe affecté à Fort Robert se blesse le pied coincé entre une tête de
bielle et une machine début juin 1909.
• L'enseigne de vaisseau Morane, commandant Fort Robert en
novembre 1915, verse 20 frs au comité de Brest qui s'occupe du "paquet
du prisonnier". Ses hommes à eux tous en font autant. L'argent va
aux prisonniers de guerre.
Cabine téléphonique de batterie


Cabine téléphonique de batterie construite en 1903 et se trouvant à l'extrême Nord-Est de la batterie haute de Fort Robert. Elle correspond à la généralisation des lignes téléphoniques militaires pour la commande d'artillerie.
Maison du gardien de Fort Robert



L'armée n'occupant pas la batterie en permanence,
un gardien est désigné pour surveiller les installations en temps de paix
et hors périodes d'exercice.
• Mr François Garand / Gorand est gardien du Fort Robert en
mars 1898. Celui-ci se blesse avec une caisse à poudre tombée sur sa jambe
gauche au niveau du tibia. Il est hospitalisé.
• Mr Garand / Gorand et le caporal-fourrier Corvé de la 7ème
compagnie du 2ème régiment d'infanterie de marine porte secours à un soldat
tombé de la falaise sur la grève le 5 mars 1899.
Latrines ?


Urinoir : 48° 20' 11.1" N / 4°33' 18.8" O.


Latrine ventilée : 48° 20' 11.4" N / 4° 33' 18.3" O


Sur une plate-forme déroctée sur laquelle, par le passé, il a existé un grand bâti, on trouve ce qui semble être des latrines et un urinoir. Position immédiate Ouest de la batterie haute de Fort Robert.
Divers

Réserve à eau renversée. Cuve en béton stockant l'eau douce pour les militaires en service dans la batterie. Alimentation souvent faite par récupération des eaux de pluie sur les toits plats des installations.




"Cube" en tôle galvanisée et goudronnée (extérieur). Montage par rivets à chaud. Enveloppe de réservoir à carburant.

Pièces métalliques brisées - batterie haute de Fort Robert.
La défense côtière avant 1939
Postes de projecteur du Goulet Roscanvel
Lunette à micromètre G de côte
Les postes de télémétrie Audouard 1880 Rosvanvel : Kerviniou - Capucins Sud réemployé - Capucins Sud - Capucins - Capucins Nord - Stiff - Espagnols Sud - Espagnols.
Poste d'observation 1920 de Cornouaille Roscanvel
Batteries : Basse de Cornouaille Roscanvel - Batterie de Beaufort Roscanvel - Vieille Batterie Roscanvel - Haute de Cornouaille Roscanvel - Poul Dû Crozon - Mort Anglaise Camaret - Capucins Roscanvel - Kerbonn Camaret + projecteur Camaret - Kerviniou Roscanvel - Pen-Hir Camaret - Tremet Roscanvel - Ty-Du Morgat - Portzic Crozon - Stiff Roscanvel - Pourjoint Roscanvel - Haute Pointe des Espagnols Roscanvel - Petit Gouin Camaret - Sud des Capucins Roscanvel - Batteries hautes des Capucins Roscanvel - Batterie de rupture ou bombardement - Batteries haute et basse du Kador Morgat - Rouvalour Crozon - Batteries Est de Roscanvel Roscanvel - Batterie du Run / Pont-Scorff Roscanvel - Batterie de l'île de l'Aber Crozon - Batterie extérieure de la Tour Vauban Camaret - Batterie de Dinan Crozon
Cabines téléphoniques de batterie
Camp Sanitaire des Capucins Roscanvel
Casernement bas de la Pointe des Espagnols Roscanvel
Casernement haut de la Pointe des Espagnols Roscanvel
Abri groupe électrogène Roscanvel
Fortifications de la Pointe des Espagnols Roscanvel
Casernement de Kerlaër Roscanvel
Casernement de Lagatjar Camaret
Camp d'internés de l'Île Longue
Corps de Garde 1846 / Fort : Aber Crozon - Camaret Camaret - Kador Morgat - Postolonnec Crozon - Roscanvel Roscanvel - Rulianec Morgat
Loi de déclassement des corps de garde 1846
Loi du 17 juillet 1874 - système Séré de Rivières
Loi du 3 juillet 1877 - réquisitions de l'armée
Caserne Sourdis & cale Roscanvel
Les forts : Fraternité Roscanvel - Landaoudec Crozon - Lanvéoc Lanvéoc - Toulinguet Camaret - Crozon Crozon
Lignes de Quélern Ouest Roscanvel
Pointe des Espagnols - Ligue Roscanvel
Poste d'inflammation des torpilles Roscanvel
Poudrière de Quelern Roscanvel
Repère d'Entrée de Port R.E.P. Roscanvel
Canon de 95mm Lahitolle Mle 1888
Histoire et évolution des calibres des canons
Abri du champ de tir de l'Anse de Dinan
L'arrivée de la téléphonie dans les postes d'observation
Les Ancres de Roscanvel Roscanvel
Château-fort de Castel bihan Poulmic Lanvéoc
La ligne d'artillerie terrestre de 1914
Les piliers des terrains militaires
Sous-marin Nautilus de Robert Fulton Camaret
1404 la chute de l'Anglais à Lam Saoz Camaret
La BAN de Lanvéoc-Poulmic Lanvéoc
La défense antiaérienne avant 1939
Position de DCA en presqu'île avant 1939
Batterie de DCA de Kerguiridic Crozon
Batterie de 100mm Pointe des Espagnols Roscanvel
Projecteur et écoute de Pen ar Vir Lanvéoc
Projecteur et écoute du Grand Gouin Camaret
Abri de projecteur de la Pointe des Espagnols Roscanvel
Station d'écoute aérienne de Messibioc Lanvéoc
Autres positions françaises de projecteurs
°°°

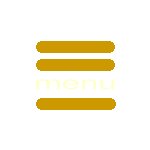


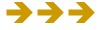 La
bouteille de
La
bouteille de 

